«Péguy?
Quand on me demande de le définir, je ne dis pas qu’il a été un grand poète, mais
un grand philosophe. Bergson déclarait que Péguy avait mieux compris certains aspects de
sa philosophie que lui-même. Il aurait obtenu une chaire à l’Université s’il
ne s’était pas battu du côté des perdants dans l’affaire Dreyfus. Et
pourtant, ce grand philosophe a été accusé d’être un irrationaliste religieux,
d’être un penseur qui, au nom d’un fidéisme mystique, s’opposait à
l’usage de la raison. Mais il s’agit là d’une énorme mystification
montée de toute pièce par ce qu’il appelait le parti des intellectuels. Une
mystification qui dure aujourd’hui encore. Mais le temps est venu de la démasquer,
de rétablir la vérité».
C’est
ainsi que parle Jean Bastaire, soixante-dix ans, Secrétaire général depuis presque
trente ans de l’Amitié Charles Péguy. L’un des rares, en France, à maintenir
vivant le souvenir de Péguy. Bastaire a publié depuis peu son "autobiographie
spirituelle" aux éditions du Cerf, sous le titre L’apprentissage de
l’aube.
Avant
tout, que représente pour Péguy le parti intellectuel?
JEAN
BASTAIRE: Péguy a pris conscience de son existence après le célèbre procès Dreyfus,
cette affaire politico-judiciaire qui a secoué la France de l’époque, suscitant des
polémiques et des affrontements féroces. La partie qui l’a emportée a ensuite
occupé progressivement tous les postes clefs: dans les journaux, à l’Université,
au gouvernement. Mais ce n’est pas cela qui a troublé Péguy: c’est quelque
chose qui, hélas!, se produit toujours quand des intellectuels se mêlent de politique et
qu’une partie prévaut sur une autre. Ce qui l’a troublé, cela a été de
découvrir que ce qui unissait ces gens, c’était non seulement le goût du pouvoir,
mais encore une même philosophie de l’existence, une même conception de la vie. Le
mépris de Péguy à l’égard des intellectuels n’est pas né de ce qu’ils
occupaient des postes clefs mais de ce qu’ils obscurcissaient les consciences.
En
quel sens obscurcissaient-ils les consciences?
BASTAIRE:
Ils avaient une fausse conception de la raison. Le parti intellectuel, dit Péguy, a une
conception rigide de la raison, il veut plâtrer la réalité dans des formules. Pour
pouvoir comprendre la réalité, la raison doit, au contraire, être souple et se modeler
sur elle. La première donnée, c’est l’expérience sensible et la raison doit
la suivre, comme une servante, pour l’éclairer. Je voudrais donner un exemple. À
cette époque, régnait la conception d’une raison scientifique, conception qui
faisait une confiance idolâtre, quasi fétichiste au progrès et pour qui l’histoire
est menée inévitablement vers son accomplissement. Mais, pour Péguy, une conception de
ce genre est contraire à la réalité et sa fausseté est immédiatement perceptible au
niveau personnel et social, car elle élimine la dimension tragique de l’existence.
Elle ne considère pas la réalité de l’homme dans son intégralité. De cette
façon, elle ne permet pas de comprendre la nature de l’homme ni le contexte social
dans lequel il vit. L’histoire du XXe siècle a donné raison en cela à Péguy: le
nazisme et le stalinisme ont montré de façon dramatique comment le progrès loin de
poursuivre sans obstacle sa marche victorieuse, peut subir des échecs, reculer, tomber
dans des abîmes vertigineux.
Et
pourtant, Péguy vient précisément de ce milieu socialiste et scientiste qui le mettait
maintenant en accusation. C’étaient les gens de ce milieu qui étaient,
jusqu’à sa conversion, ses camarades de route. Quelle a été leur réaction?
BASTAIRE:
Quand Péguy, avec la publication du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, a
manifesté explicitement qu’il était chrétien, ses compagnons de route se sont dit:
«Voilà, il trahit la raison, il tombe dans le mysticisme et dans le sentimentalisme.
C’est un philosophe perdu pour nous et pour notre bataille». À coup d’articles
et de pamphlets, ils ont prononcé une véritable oraison funèbre de son intelligence
qui, disaient-ils, passait non seulement du côté des "curés" mais encore du
côté de l’irrationalisme.
Et
Péguy, comment a-t-il répondu à ces accusations?
BASTAIRE:
Il a réagi violemment. Car sa bataille, il la livrait au nom de la raison, pour défendre
la raison, contre ceux qui en falsifiaient l’usage. Ce qu’il demandait, ce
n’était pas un "moins", mais un "surplus" de raison. Il était
philosophe de métier et il ne supportait pas cette mystification qui le faisait passer
pour irrationaliste. Dans la Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne il écrit,
irrité: «On a feint de croire que la querelle faite à l’intellectualisme était
une querelle faite à la raison, à la sagesse, à la logique. Et à
l’intelligence». Au contraire, c’était justement au nom de la raison que
Péguy combattait le parti des intellectuels. Car l’arrogance de ces intellectuels
est une arrogance contre la réalité. Péguy constate que ceux qui mythifient la raison
arrivent à des positions qui sont contraires ou étrangères à la réalité. Lui, au
contraire, il la défend et proclame «le respect religieux de la réalité souveraine et
maîtresse absolue du réel comme il vient, comme il nous est donné, de
l’événement comme il nous est donné». Ce n’est pas nous qui faisons la
réalité, nous devons la reconnaître: l’homme doit être à son service. La
créature humaine ne peut pas créer la moindre partie de la réalité. Nous mêmes, nous
ne faisons que nous recevoir. Péguy a formé sur ce thème un délicieux néologisme:
«Ce siècle qui se dit athée ne l’est point, il est auto-thée. [...] L’homme
s’est littéralement fait son propre dieu». C’est comme si l’homme se
donnait à lui-même et refusait le fait que nous nous recevons d’un autre. Et
pourtant, il est tellement évident que l’homme ne se fait pas par lui-même! Que sa
réalité lui est donnée. Mais par le moyen d’un réseau de lois scientifiques,
d’affirmations absolues et catégoriques, l’homme se rassure et se confirme dans
la certitude totalement folle et totalement vaine qu’il est à l’origine de la
réalité, qu’il est, d’une certaine façon, son propre maître et son propre
tyran.
Est-il
possible que dans les milieux rationalistes, il n’y ait personne d’assez
intelligent pour s’apercevoir que la réalité est toujours au-delà de tout système
de pensée?
BASTAIRE:
Il est sûr que les plus intelligents s’en aperçoivent, mais, dans ce cas, ils ont
recours à ce que Péguy appelle «la stratégie du coup de pouce». C’est comme
lorsque qu’une montre retarde un peu, ne marche pas très bien et menace de
s’arrêter. On lui donne un petit coup, un petit "coup de pouce" et voilà
qu’elle repart et qu’elle semble à nouveau marcher parfaitement bien. Si la
réalité ne coïncide pas avec le concept produit, on donne un coup de pouce pour la
faire entrer dedans. Il suffit de supprimer une petite partie de la théorie ou
d’éliminer une des données de la réalité qui ne coïncide pas avec le système,
et tout semble se remettre en marche. Mais, dit Péguy, il ne s’agit pas là
seulement d’une infidélité à la réalité. C’est aussi une infidélité à la
raison. Car, en procédant ainsi, on affaiblit la rigueur de la raison. Quand la réalité
se refuse à entrer dans un système de pensée et qu’on l’y fait entrer de
force, la raison, de servante qu’elle était, devient maîtresse. Mais la réalité
n’est pas un système. Elle nous dépasse, elle nous déborde de partout.
Mais
ce parti intellectuel n’était pas présent seulement dans le monde scientiste...
BASTAIRE:
Tout au contraire. Péguy le compare à une hydre aux multiples têtes. Et l’une
d’elles se trouve dans le monde catholique. Peut-être la plus dangereuse. Péguy
attaquait aussi durement le scientisme rationaliste que le traditionalisme catholique qui
avait un moment pensé pouvoir se l’"annexer". Certes, quand, au début, il
parle de la section catholique du parti intellectuel, il pense en particulier aux
néo-thomistes dont Jacques Maritain deviendra le chef de file. Ces néo-thomistes
avaient, eux aussi, une conception rigide de la raison: la foi était un système dans
lequel englober toute la réalité. Péguy en avait fait personnellement
l’expérience. Il suffit de voir avec quelle rudesse inouïe ils ont traité son
problème conjugal (Péguy avait épousé une femme athée qui refusait de faire baptiser
ses enfants), comment ils ont réduit la foi à des formules dans lesquelles la personne
était comme annulée. Ils commettaient une erreur que l’on voit encore souvent
aujourd’hui: ils pensaient que pour obéir aux dogmes de l’Église il fallait
adopter une attitude de rigueur. Or il n’en va pas ainsi. Le dogme ne peut être la
pétrification d’une vérité vivante. Les néo-thomistes soutenaient que la raison
doit obéir à la foi. Il n’en va pas ainsi. La raison doit obéir seulement à la
réalité, selon la totalité de ses possibilités. Ainsi, elle ne se dénature pas
elle-même et il n’y a pas de contradiction entre raison et foi. Bref, au début,
Péguy s’en prenait à la rigidité des néo-thomistes; puis, il s’est aperçu
que le parti intellectuel est beaucoup plus ramifié dans l’Église. C’est une
découverte déconcertante qui l’en a convaincu.
Laquelle?
BASTAIRE:
C’est quelque chose qu’il dénonce depuis la première version de Clio, qui date
de 1909 et qui est sa première œuvre chrétienne. Il y a quelque chose que le parti
intellectuel catholique «ne veut pas reconnaître, ne veut pas voir». C’est
l’inchrétienté de l’époque moderne. L’établissement de ce qu’il
appelle dans l’une de ses œuvres les plus fortes, Véronique, écrite en 1909,
«un monde inchrétien, déchristianisé, absolument, littéralement, totalement
inchrétien». Péguy ne parle pas de déchristianisation: car ce terme impliquerait
qu’il reste encore du christianisme. L’inchrétienté implique, au contraire que
le christianisme n’existe plus. Qu’il n’y a plus rien. Nous,
aujourd’hui, nous vivons dans le monde que Péguy a décrit, dans le monde qu’il
a vu naître. Dans la société qui est la nôtre, les gens qui ont moins de cinquante ans
ne sont pas déchristianisés, ils sont totalement inchrétiens. Ils sont aussi
inchrétiens que les habitants de la Papouasie ou de la Chine. Le christianisme se réduit
à quelque vague notion lue dans des livres ou vue dans de curieuses cérémonies. On en
arrive à regretter le temps des polémiques féroces contre le christianisme qui
témoignaient d’une déchristianisation. Au temps de Péguy, les adversaires
connaissaient le christianisme; ils savaient de quoi ils parlaient; entre partisans et
opposants, il y avait un langage commun, et dans la lutte aussi. Aujourd’hui, nos
contemporains ne savent pas ce qu’est le christianisme. Ou ils en savent ce
qu’ils lisent dans les journaux où ils trouvent des renseignements sans importance
et sans intérêt, à côté des résultats sportifs (qui, d’ailleurs, les
passionnent bien davantage).
Il
s’agit d’une situation d’inchrétienté nouvelle dont Péguy s’était
rendu compte. La dernière forme d’espoir laïque, le marxisme, a abouti, elle aussi,
à un échec et elle est devenue l’objet d’une dérision si vive que personne
n’ose plus la défendre. Le christianisme n’a pas cédé la place à un nouvel
espoir, comme le souhaitaient les scientistes: il n’y a plus, tout simplement, ni
religion ni espoir. Comme le souligne Péguy, personne n’est plus disposé à mourir
pour sa foi, qu’elle soit païenne ou chrétienne, scientifique ou patriotique. Non
pas que nos contemporains soient des monstres d’égoïsme: ils aimeraient croire, ils
cherchent quelque chose en quoi ils puissent croire. Mais ils ne sont pas seulement
inchrétiens, ils sont aussi "inlaïques", car ils ne sont rien. Et personne ne
leur propose rien qui vaille la peine d’être suivi, pour lequel il vaille la peine
de mourir.
Et
ce qui est proposé en général, et par l’Église aussi, n’a pas toujours le
charme de la nouveauté. Monseigneur Giussani a dit au Synode des évêques en 1987: «Ce
qui manque aujourd’hui dans l’Église, ce n’est pas tant la répétition
littérale de l’annonce que l’expérience d’une rencontre. L’homme
d’aujourd’hui attend peut-être inconsciemment l’expérience de la
rencontre avec des personnes pour lesquelles le fait du Christ est une réalité si
présente que leur vie s’en trouve changée».
BASTAIRE:
Péguy aurait été d’accord. Je ne crois pas que Péguy, tout en affirmant avec
force la visibilité du christianisme, aurait applaudi à une forme
d’évangélisation triomphaliste, médiatique, organisatrice. Pour lui, le cœur
de l’annonce était le contact d’homme à homme, le témoignage qui se transmet
d’une personne à l’autre. Et on est étonné du cri de douleur que Péguy
prête à Jeanne d’Arc face à Mme Gervaise, la maîtresse des novices, qui lui
répète de ne pas douter parce qu’ «Il est là comme au premier jour». Et Jeanne
crie: «Il faudrait peut-être autre chose, mon Dieu, vous qui savez tout. Vous savez ce
qui nous manque. Il faudrait peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qu’on
aurait encore jamais vu, quelque chose qu’on aurait encore jamais fait. Mais qui
oserait dire, mon Dieu, qu’il puisse encore y avoir du nouveau après quatorze
siècles de chrétienté?». C’est le désir d’une nouveauté qui renouvelle la
vie, qui rende vraie dans le moment présent la vérité dogmatique. C’est un désir
dramatique. Parce que, d’une part, tout a été accompli à un moment de
l’histoire, sur le Golgotha et le matin de Pâques. Mais, d’autre part, il est
nécessaire que le Christ ressuscité se répande sur tous les siècles et ainsi
renouvelle toutes les époques de l’histoire. C’est vrai: dans cet instant de
l’histoire tout a été accompli et il n’y a plus rien de nouveau depuis que le
Christ est mort et ressuscité. Mais tout est encore à renouveler. La création, elle
aussi, a duré six jours. Et le christianisme nous enseigne que rien, dans la vie,
n’est défini une fois pour toutes. Tout suscite en nous une inquiétude. Une
inquiétude qui nous sauve dans la mesure où elle nous guide vers le salut. Et Péguy
nous conjure de ne pas laisser notre âme s’endormir, de la maintenir en état
d’inquiétude, de ne pas l’échanger contre «une âme toute faite». Car,
explique-t-il, il n’y a plus, dans ce cas, ni grâce ni force jaillissante. Et pour
nous maintenir en état d’inquiétude il faut regarder la réalité. Or «personne ne
défend plus la réalité, mis à part les pauvres et les misérables comme nous, les
mendiants comme nous, individus sans mandat».

Moïse, Samuel et David, portail nord
(Péguy)

Saint Martin et saint Jérôme
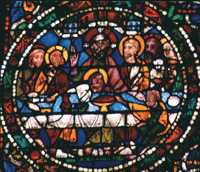
La dernière cène

Le lavament des pieds

Saint Léon et saint Ambroise

Apôtres, détail de l‘architrave du portail central

Les trois Marie au sépulcre

Marie-Madeleine et Jésus ressuscité
(Péguy)

La Cathédrale de Chartres