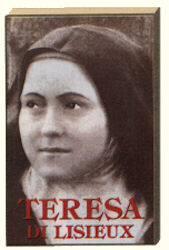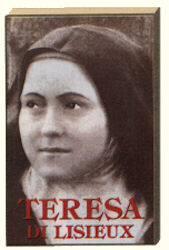 |
La grâce et la gloire
par Giovanni Ricciardi
"Je ne vois pas bien ce que j'aurai de plus après la mort... Je verrai le
bon Dieu, c'est vrai, mais pour être avec Lui, j'y suis déjà tout à fait sur la
terre". Nous trouvons dans ces déclarations paradoxales l'idée de Thérèse (idée
si nouvelle dans l'histoire du sentiment religieux occidental) selon laquelle la vie de
foi est -malgré sa précarité et sa fragilité - enviable. C'est ainsi que s'exprime
Jean Guitton. Interview |
En
1954, Jean Guitton avait écrit un Essai sur le génie spirituel dans la doctrine de
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Publié par les Annales de Lisieux, ce texte avait
été amplifié et réédité en 1965. Un écrit, en un certain sens, prophétique.
Guitton mettait, pour la première fois, en pleine lumière, au centre de sa réflexion
sur Thérèse, la profondeur de la doctrine de la sainte de Lisieux. Ce petit volume, qui
est passé presqu'inaperçu en son temps, redevient d'actualité maintenant que Jean Paul
II vient de proclamer Docteur de l'Église la sainte de la "petite voie".
Redécouvert par Monseigneur Guy Gaucher, évêque auxiliaire de Lisieux, il a été
réimprimé récemment en France (Le Génie de Thérèse de Lisieux, Éd. de l'Emmanuel,
1995) et en Italie (J. Guitton, Il genio di Teresa di Lisieux, Turin, Sei, 1995). Nous
avons demandé à J. Guitton, de reprendre son essai pour nous résumer sa pensée sur
Thérèse. Pensée qui n'a pas changé depuis cette époque. "Un de mes maîtres -
écrit le philosophe dans l'avant-propos à la nouvelle édition - m'avait dit:
"Écrivez de manière que ce que vous écriviez soit un aliment pour les esprits, une
nourriture pour les âmes", et j'ai toujours tenté de suivre ce conseil. C'est
pourquoi ce que j'ai écrit là n'a pas vieilli".
Tous les saints n'ont
pas ce caractère de charme. Le charme parfait ne peut convenir pleinement à un adulte.
Il exige une sorte d'enfance, il implique une ignorance de ce charme même: un charme qui
aurait conscience de soi s'évanouirait
|
Monsieur
le Professeur, en quoi consiste le "génie" de Thérèse de Lisieux?
JEAN
GUITTON: Dans la simplicité de la synthèse. Qui est d'ailleurs la simplicité de
l'enfant. Le génie de Thérèse, c'est d'avoir pu d'emblée atteindre cette simplicité
qui ne sera donnée aux sages et aux savants qu'après des efforts, beaucoup d'échecs et
de longues patiences.
L'Église
vient de la proclamer "Docteur de l'Église". Votre essai de 1954 laissait
déjà entrevoir, implicitement, la possibilité de cette reconnaissance. D'où est partie
votre réflexion?
GUITTON:
La situation était la suivante. Que Thérèse fût une sainte religieuse, une religieuse
sainte, canonisable, canonisée, marquée de ce halo qu'on appelle le charme, nul ne le
contestait, au moins parmi les catholiques. Mais la question était de savoir si Thérèse
appartenait à l'assemblée commune des saints, ou si elle devait être rangée dans la
phalange des saints de génie, si l'on devait la compter parmi ces êtres très rares qui
ont tiré de l'éternel trésor évangélique des voies et pour ainsi dire des vérités
de vie nouvelles. Pour moi, jusqu'à une certaine période de ma vie, je ne m'étais
jamais posé ce problème. J'étais intéressé mais non "ravi" par Thérèse de
l'Enfant-Jésus. C'est paradoxalement un "non-catholique" qui m'a ouvert cette
perspective.
De
qui s'agit-il?
GUITTON:
Durant mes années de captivité, j'ai lu le livre d'un penseur orthodoxe russe,
Merejskowski, appelé De Jésus à nous. Le subtil écrivain slave, ami de Dostoïevski,
partait de l'idée que , "de Jésus à nous", il n'y a eu que cinq ou six saints
de génie: saint Paul, saint Augustin, saint François d'Assise, sainte Jeanne d'Arc. Ce
qui m'a surpris c'est que, de mon côté, m'étant secrètement posé la même question,
j'étais arrivé presque aux mêmes noms. Mais après Jeanne d'Arc et sainte Thérèse
d'Avila, j'hésitais, perdu dans l'abondance des temps contemporains. Merejskowski
n'hésitait pas, lui. Lui, russe et non catholique, il nommait avec certitude, avec défi,
Thérèse de l'Enfant-Jésus. Et, la comparant avec Jeanne d'Arc, il voyait, en elles
deux, le même esprit, agrandi, chez Thérèse, aux dimensions du monde moderne, de ses
difficultés, de ses luttes terribles et imminentes.
 |
| Thérèse de Lisieux proclamée
Docteur de l'Église par Jean Paul II le 19 octobre dernier |
Pourquoi?
GUITTON:
Parce que - disait-il - Jeanne et Thérèse ont eu un esprit d'innovation surprenant. Au
lieu de voir dans la sainteté une montée vers le ciel hors de la terre, elles
considéraient que le ciel devait voir se poursuivre l'œuvre de mission qui nous a
été donnée sur terre. Elles aimaient vraiment la terre des hommes non pas comme un
moyen, mais pour elle-même, comme le Créateur.
On
pourrait dire aussi que l'esprit de Thérèse retrouvait l'intuition luthérienne dans ce
qu'elle avait de positif, que son offrande à l'amour miséricordieux contient le solide
de l'idée de Luther sur la foi qui sauve, au-delà des œuvres. Ou encore, que son
"Rien que pour aujourd'hui", son idée de l'éternité tout entière déjà
présente dans cet exquis moment qui passe, c'est la vérité que Gide a invertie dans ses
fameuses Nourritures terrestres. Et, plus généralement, que cet amour de la Terre des
hommes, de la condition humble, militante et souffrante, des "petites âmes",
des "moyens courts", des moyens simples, des actes perdus et insignifiants, de
la totalité - en somme toute la spiritualité immanente au monde moderne - est déjà
toute présente en elle. Oui, certes, et jusqu'à l'angoisse, jusqu'à l'expérience du
doute radical sur tout, jusqu'à la saveur quasi baudelairienne du néant.
Il
est singulier qu'un Russe comme Merejskowski place justement, au terme de sa liste des
saints de "génie", Jeanne et Thérèse, les deux patronnes de la France.
GUITTON:
Il est même curieux de constater que, sous son regard de voyant, condensant et ramassant,
Merejskowski rassemble et identifie presque les deux Vierges, qui, au moment où il
écrivait, n'étaient pas encore les deux patronnes de la France. Il faut citer:
"Si
la France fut réellement sauvée par Jeanne, toute l'Europe le fut aussi: le salut ou la
ruine de la France, partie la plus vivante du corps européen, étant la vie ou la mort du
corps entier, cette vérité si évidente pour nous au XXe siècle fut déjà pressentie
au XVe par Jeanne. Deux grandes saintes - l'une apparue dans la France chrétienne des
siècles passés, l'autre dans la France déchristianisée de nos jours - sainte Jeanne
d'Arc et sainte Thérèse de Lisieux. Celle-ci ne ressemble pas à celle-là, comme le XXe
siècle ne ressemble pas au XVe. Mais Jeanne n'aurait-elle pas pu dire comme Thérèse:
"Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre"? Dans cette expérience
religieuse exprimée par Thérèse avec une telle précision et vécue par Jeanne en
silence (avec une profondeur telle que peut-être jamais elle n'a été exprimée et
vécue par aucun autre parmi les grands saints), dans cette volonté d'action humaine et
terrestre, qui est la source de leur sainteté, non seulement elles se ressemblent, mais
elles ne font qu'une seule et même âme dans deux corps: les deux France, celle du passé
et celle de l'avenir. De ce monde-ci vers l'autre, de la terre vers le Ciel, tel est le
chemin ascendant de tous les saints! Il n'y a que Jeanne et Thérèse dont la voie soit
inverse, descendante du Ciel vers la terre, de l'autre monde vers celui-ci".
L'idée
de Merejskowski était que Jeanne et Thérèse étaient les deux saintes les plus
modernes, les plus révolutionnaires et d'une révolution qui commence à peine et qui
nous entraîne dans un nouvel âge.
Est-ce
pour cela que Thérèse de Lisieux exerce un charme particulier?
GUITTON:
En quoi consiste le charme de tout être? Cela est difficile à dire, car le charme ne se
définit pas. Il est une certaine présence de la personne au-delà de ses limites, comme
l'irradiation de certains visages purs. Il est aussi une certaine aisance des gestes, des
paroles, des actes, des conduites même les plus sacrifiées, qui fait que ce que fait un
être semble un jeu divin, jailli de lui sans effort et par communication avec la source
du Bien.
Il y avait
certainement en Thérèse le paradoxe du "génie" - ou de l'"enfance",
ou de la "grâce" - paradoxe qui fait que les actes difficiles semblent simples
et naturels
|
Tous
les saints n'ont pas ce caractère de charme. Le charme parfait ne peut convenir
pleinement à un adulte. Il exige une sorte d'enfance, il implique une ignorance de ce
charme même: un charme qui aurait conscience de soi rappellerait l'art des acteurs et
s'évanouirait.
Il est
vrai qu'en Thérèse le charme et la méthode ne se séparent guère. Mais le mot charme,
si jamais il peut être appliqué à un saint, désigne et même caractérise sœur
Thérèse de l'Enfant-Jésus. C'est pourquoi sa méthode se distinguera mal de sa
personne.
Est-il
possible de décrire, dans ses grands lignes, cette "méthode"?
GUITTON:
C'est, en réalité, bien difficile, car sa "méthode" n'est pas si communicable
qu'elle paraît et que Thérèse le croit. Il y avait certainement en Thérèse le
paradoxe du "génie" - ou de l'"enfance", ou de la "grâce"
- paradoxe qui fait que les actes difficiles semblent simples et naturels. On peut,
pourtant, essayer d'en définir quelques aspects.
Par
exemple?
GUITTON:
L'amour de la condition terrestre. Dans les pages de Thérèse, nous lisons des phrases
comme celles-ci: "Nous n'avons que les courts instants de notre vie pour aimer
Jésus" (LT 92).
Ou
bien: "Je ne vois pas bien ce que j'aurai de plus après la mort... Je verrai le bon
Dieu, c'est vrai, mais pour être avec Lui, j'y suis déjà tout à fait sur la
terre" (DE 15.5.7).
Dans
ces déclarations paradoxales, nous retrouvons l'idée de Thérèse (si nouvelle dans
l'histoire du sentiment religieux occidental) que, malgré sa précarité et sa
fragilité, la condition mortelle, la vie de foi est enviable.
À bien
y réfléchir, une pensée de ce genre est contenue dans l'idée même de création et
surtout dans celle d'incarnation.
À
cette intuition se relie la valeur d'éternité que Thérèse attribue à l'instant
présent. Voici ce qu'on lit dans son cantique: "Ma vie n'est qu'un instant, une
heure passagère, / Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit". Puis
elle continue: "Tu le sais, ô mon Dieu! pour t'aimer sur la terre, /Je n'ai rien
qu'aujourd'hui. [...] Que m'importe, Seigneur si l'avenir est sombre? / Te prier pour
demain, oh! non, je ne le puis!.../ Conserve mon cœur pur, couvre moi de ton ombre /
Rien que pour aujourd'hui ".
Selon
moi, Thérèse veut dire que l'attente est déjà une possession latente, que la vie de
grâce anticipe le paradis et le fait savourer, que l'ombre est douce quand c'est l'ombre
de Dieu.
Dans
une lettre de 1890 à sa sœur Céline, Thérèse écrit: "Déjà, Dieu nous voit
dans la gloire, il jouit de notre béatitude éternelle!" (LT 108).
Cette
dernière pensée n'est-elle pas en contradiction avec la valeur exceptionnelle que
Thérèse accorde à l'instant présent?
Nous sommes donc à l'opposé de
l'idée de Pélage pour qui l'effort humain était la cause unique de la récompense
céleste. Pour Thérèse, comme pour saint Augustin, c'est la grâce (dont la gloire est
la visibilité) qui est la cause première des mérites
|
GUITTON:
Cette pensée, prise en elle-même, est fort audacieuse. Et, seule, l'Enfant peut se la
permettre. Thérèse se place d'emblée du point de vue de Dieu prédestinant. Dans ses
audaces, l'Enfant se donne le droit d'accéder au plan divin de la prédestination
d'amour. Dans ce plan, Thérèse ne peut se voir qu'aimée et Dieu jouissant de la
béatitude de son âme.
Nous
sommes donc à l'opposé de l'idée de Pélage pour qui l'effort humain était la cause
unique de la récompense céleste. Pour Thérèse, comme pour saint Augustin, c'est la
grâce (dont la gloire est la visibilité) qui est la cause première des mérites.
Parmi
les différents aspects de la personnalité de Thérèse, vous insistez dan votre livre
sur son "sens du vrai". Qu'entendez-vous par cette expression?
GUITTON:
"Je ne puis me nourrir que de la vérité", dit Thérèse. Cet esprit de
vérité est remarquable chez elle. On la voit toujours désirer cet aliment et ne le
trouver que dans ce qui est sans exagération, ni légende, ni boursouflure. Thérèse
n'avait pas une culture critique. Mais on devine en elle une faculté critique. De même
que Jeanne d'Arc qui n'est pas théologienne. Mais, en écoutant les réponses de son
Procès, on devine une intelligence théologale, une étonnante faculté de résolution
des cas posés à la conscience.
Durant
sa dernière maladie, Thérèse disait, par exemple, que, pour qu'un sermon sur la
Sainte-Vierge lui plût et lui fît du bien, il fallait qu'il lui fît voir sa vie
réelle, non sa vie supposée (cf. DE 23 6). Le 5 août, deux mois avant qu'elle ne meure,
une sœur lui disait, qu'à sa mort, les anges viendraient pour
l'accompagner:"Toutes ces images", répliqua Thérèse, "ne me font aucun
bien, je ne puis me nourrir que de la vérité. C'est pour cela que je n'ai jamais
désiré des visons... J'aime mieux attendre après ma mort".
Cette
absence d'intérêt pour les visions ne l'empêche pas pourtant pas de s'imaginer dans la
gloire du Ciel.
GUITTON:
Lorsque Thérèse se représentait le Ciel, elle ne pouvait le concevoir que comme lui
permettant l'exercice d'une charité envers les âmes. Thérèse Martin compte être
encore active dans la gloire et travailler efficacement... Elle écrit dans l'une de ses
prières: "Mon Dieu, donnez-moi de pouvoir agir éternellement avec vous!".
On
pense aux paroles que saint Ignace d'Antioche adressait aux chrétiens de Rome:
"Notre Dieu Jésus-Christ, maintenant qu'il est retourné chez son Père, se
manifeste davantage". Y a-t-il quelque chose de semblable dans l'intuition de
Thérèse?
GUITTON:
Oui, pour Thérèse, le Ciel est le lieu d'une action continue, de type angélique; elle
pense que c'est à la mort qu'il faut, pour ainsi dire, être armé chevalier et commencer
ses fonctions d'Ange de Dieu. Le moment solennel ne sera pas l'heure où elle inaugurera
son repos, mais ce sera l'heure d'une activité illimitée puisque la vie dans le corps
imposait à son action des bornes.
Et,
effectivement, c'est après sa mort que Thérèse a fait sentir sa présence dans la vie
de l'Église de notre siècle. Par exemple à travers l'énorme diffusion de son journal,
l'Histoire d'une âme.
GUITTON:
Oui, le petit cahier de Thérèse a été le best-seller du XXe siècle.
Pourquoi
cet énorme succès?
GUITTON:
Parce que Thérèse exprimait dans une langue simple, enfantine, géniale - c'est-à-dire
ingénue - ce que saint Paul a dit, à savoir que l'amour que l'Esprit Saint répand dans
le cœur des fidèles est tout et qu'un seul acte d'amour pur vaut plus que toutes les
pratiques ascétiques. Ainsi Thérèse a rendu témoignage, presque sans s'en apercevoir,
à la célèbre pensée de Pascal: "Tous les corps, le firmament, les étoiles, la
terre et ses royaumes, ne valent pas le moindre des esprits. Car il connaît tout cela, et
soi, et les corps rien.
Tous
les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toutes leurs productions ne valent pas
le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé.
De tous
les corps ensemble on ne saurait en faire réussir une petite pensée; cela est impossible
et d'un autre ordre. De tous les corps et esprit on n'en saurait tirer un mouvement de
vraie charité; cela est impossible, et d'un autre ordre surnaturel". Ainsi Thérèse
écrit-elle: "Lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi".